Lorsque Simona Isler a décidé de faire son doctorat, elle a eu le sentiment que cela pourrait rendre compliqué son entrée dans le monde du travail. Néanmoins son désir de traiter scientifiquement un sujet qui lui tient à cœur et la volonté de le faire étaient plus grand que ses craintes. Voici l’entretien avec l'actuelle responsable de l'égalité dans l'encouragement de la recherche du Fonds national suisse (FNS).
Olympiades de la science : Simona Isler, vous êtes responsable de l'égalité dans l'encouragement de la recherche du Fonds national suisse (FNS). Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Comment devons-nous imaginer votre vie quotidienne ?
Simona Isler: Je suis responsable du domaine de l'encouragement de la recherche. Mon travail concerne donc les chercheuses soutenues par le FNS et non les collaboratrices du bureau administratif. J'ai une fonction transversale qui comprend des tâches stratégiques, communicatives et opérationnelles. Par exemple, j'ai participé à la préparation du programme pluriannuel 2021-2024 car l'égalité a été établie ici comme une priorité. Je fais aussi beaucoup de travail de communication, j'écris des nouvelles avec le département de communication ou je suis invitée par des universités et des institutions pour des conférences. Il y a aussi des tâches opérationnelles : je suis la personne de contact pour le Flexibility Grant (contribution pour les chercheuses ayant des enfants à charge) et j'organise des ateliers, des séances de coaching et les manifestations du programme Prima Leadership pour les chercheuses ayant reçu un subside PRIMA du FNS.
"Je crois que mes supérieurs voulaient une personne jeune et un peu effrontée. J'apporte les deux avec moi (rires)."
Quelles étapes vous ont conduits à votre travail actuel ? Y a-t-il eu une décision ou une rencontre particulière sans laquelle vous ne seriez pas ici aujourd'hui ?
J'ai étudié l'histoire puis j'ai fait mon doctorat en me spécialisant dans l'histoire du mouvement des femmes, du féminisme et du travail des femmes. J'ai écrit ma thèse sur la politisation du travail dans le mouvement des femmes vers 1900, et alors que je rédigeais encore ma thèse, j'ai postulé à un emploi au sein du FNS, mais honnêtement je ne pensais pas être retenue. Quand j'ai été acceptée, j'étais très heureuse. En plus de mes qualifications en termes de contenu, j'ai dans mon bagage de nombreuses années d'engagement féministe - une expérience toute aussi importante. Je crois que mes supérieurs voulaient une personne jeune et un peu effrontée. J'apporte les deux avec moi (rires).

Avec votre doctorat, vous abordez un sujet qui occupe l’esprit de nombreux anciens participant.e.s des Olympiades de la science. Devrait-on faire un doctorat ou pas ? Pourquoi avez-vous décidé de le faire ?
Avec du recul, ma carrière semble rectiligne : des études, un doctorat, puis un poste où la thèse était exigée. Mais au moment où j'ai dû prendre la décision de faire un doctorat j'avais imaginé mon avenir différemment. Je n'ai pas fait la thèse pour des raisons professionnelles, je le savais déjà à l'époque : je ne voulais pas rester dans le domaine des sciences. J'ai eu mon premier enfant durant mes études et mon deuxième pendant la thèse. Il était clair pour moi que je ne voulais pas devenir professeur à cause de l'incertitude constante, des bas salaires, de la mobilité et de la pression de la carrière. Je ne voulais pas travailler à 150 % mais avoir du temps pour d'autres choses - pour le féminisme et pour mes enfants, par exemple.
Je m’étais donc déjà posé la question de savoir si une thèse a un sens. Je savais qu'avec le doctorat je postulerai aux mêmes postes qu'avec le master avec toutefois moins de chances de trouver du travail car je serais surqualifiée, trop vieille et toujours sans aucune expérience professionnelle. Le doctorat était une boucle qui semblait superflue d'un point de vue professionnel, inutile, peut-être même contre-productif. Mais je voulais vraiment le faire ! J'ai beaucoup apprécié réaliser le master et j'avais très envie d'approfondir le sujet. Je me suis dit à l'époque que j’allais m'offrir quatre ans de plus pour lire les livres que j'avais envie de lire depuis longtemps et pour continuer le sujet qui me tient à cœur. C'était ma motivation et ça a finalement marché. Comme si je l'avais planifié intelligemment, une carrière qui se terminerait par un emploi sûr, bien rémunéré et toujours passionnant - mais ça ne s’est pas passé comme ça.
"J’ai constaté que les travaux ménagers et le travail rémunéré pouvait être perçu de diverses manières, il en va de même pour les concepts de ce qui est un « bon » travail ou un travail dit « émancipé »."
Ma conclusion ? Ça vaut la peine de faire ce qu'on veut faire. Ça a marché pour moi, ça a même mieux marché que je le pensais. Je m'attendais à être au chômage pendant une demi-année après la thèse, puis obtenir un emploi mal payé dans une ONG - et j'aurai accepté cela. J'ai eu beaucoup de chance. Je connais d'autres personnes pour lesquelles ça a été plus difficile.
Votre histoire montre que les sujets du féminisme et de l'égalité sont votre passion. Comment en êtes-vous arrivé là ? Y a-t-il eu un moment particulier où vous avez été confrontée à l'injustice où vous vous êtes dit : « Je dois faire quelque chose à ce sujet ? »
J'ai été marquée par la naissance de mon fils pendant mes études. J'ai alors réalisé que je voulais passer beaucoup plus de temps avec lui. Les 16 semaines de congé maternité n’étaient pas suffisantes. J'ai aussi réalisé que ce serait financièrement difficile. Je travaillais encore à 40 % et je ne progressais pas dans mes études. A un moment donné, j'ai été dépendante d'aides. Je me suis rendu compte que je travaillais énormément - études, garde d'enfants, emploi rémunéré - et que je ne pouvais toujours pas aller plus loin. J'étais pauvre et je pouvais à peine finir mes études.
C'est là que mon intérêt pour ces questions s’est développé et avec deux amies, je me suis engagée plus intensément dans l'économie féministe. Pour mon travail de master, j'ai analysé le débat sur les tâches ménagères dans le féminisme des années 70. J’ai constaté que les travaux ménagers et le travail rémunéré pouvait être perçu de diverses manières, il en va de même pour les concepts de ce qui est un « bon » travail ou un travail dit « émancipé ».

"Ma conclusion ? Ça vaut la peine de faire ce qu'on veut faire. Ça a marché pour moi, ça a même mieux marché que je le pensais. J'ai eu beaucoup de chance. Je connais d'autres personnes pour lesquelles ça a été plus difficile."
Vous êtes historienne. Pourquoi avez-vous décidé d'étudier l'histoire il y a des années ? Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important dans le choix d'un programme d'études ?
L'histoire était ma matière préférée au lycée. Mes deux professeurs ont rendu les leçons très intéressantes, il y avait de la place pour les discussions politiques, ce qui m'intéressait déjà beaucoup à l'époque. Avant de choisir mes études, j'ai longuement réfléchi à la question de savoir si je devais vraiment étudier ma matière préférée. Ce choix me semblait trop évident et facile. Pendant un temps, j'ai joué avec l'idée de faire quelque chose de complètement différent comme les mathématiques. Mais j'en suis venu à la conclusion que je devais étudier l'histoire et si ce choix était à refaire, je prendrai la même décision.
Changeons de sujet. Les Olympiades de la science mettent d’avantage l'accent sur les sciences naturelles. Que pensez-vous de la collaboration entre les sciences humaines et les sciences naturelles au FNS ? Y a-t-il des failles ?
Ce qui est passionnant avec le FNS c'est que toutes les disciplines sont représentées. Il y a toujours des frictions, mais pas nécessairement en termes d'égalité. Le FNS veut les mêmes critères et les mêmes règles partout, mais il y a toujours des voix critiques provenant des sciences humaines en particulier. Par exemple en ce qui concerne la durée du doctorat, qui est généralement plus longue aux sciences humaines qu’aux sciences naturelles. Ici, il est important de trouver un équilibre afin de rendre justice à tous.
Le conseil de lecture de Simona : Frauen im Laufgitter, Iris von Roten. "Le livre date des années 50, vous devez le lire dans ce contexte. Il traite en même temps de manière minutieuse à des questions qui nous préoccupent encore aujourd'hui en matière d'égalité tout en analysant avec une précision déconcertante les conditions sociales misogynes. D'une part vous pourrez constater à quel point l'écrivaine est en colère et radicale et d’une autre part, c'est également un livre très drôle et voluptueux qui est idéal comme lecture au coucher".
En ce qui concerne la Commission de l'égalité dans l'encouragement de la recherche, il est important pour nous que les membres ne viennent pas uniquement des sciences humaines ou sociales, mais qu'au moins une personne vienne du secteur MINT ou des Life Sciences. Mais il est vrai que nous recherchons des personnes qui s'occupent de ces questions de manière théorique, et celles-ci viennent généralement des sciences humaines ou sociales.
Si l’on suit la route des sciences humaines comme vous l’avez fait, l'écriture devient un compagnon constant. Quels types de textes écrivez-vous pour votre travail au FNS ? Dans quelle mesure sont-ils différents de l'écriture académique ou journalistique ?
En tant qu'étudiante, j'ai travaillé pour la rédaction en ligne de « Der Bund », mais je n'étais pas vraiment impliquée dans le journalisme. Je me suis vite rendu compte que les affaires quotidiennes n'étaient pas pour moi. J'ai pris plaisir à écrire ma thèse, mais ça a été éprouvant. Ecrire une monographie signifie rassembler beaucoup d’énergie encore et encore pour ouvrir ce document et en tirer un livre entier. Ce que j'apprécie dans mon travail actuel, c'est le rythme plus soutenu : J'écris une nouvelle ou un rapport sur un sujet très précis, puis je passe au texte suivant. L'inconvénient bien sûr, c’est que vous pouvez aller moins en profondeur qu'avec un livre. Ce que je réalise à l’instant c’est qu’en tant que spécialiste des sciences humaines, j'ai appris un métier qui m'est maintenant utile. Je sais créer un texte cohérent en peu de temps.
Pour en savoir plus:
Entretien: Lara Gafner, présidente des Olympiades de philosophie et étudiante en Master d'histoire et de philosophie du savoir à l'ETH Zurich.



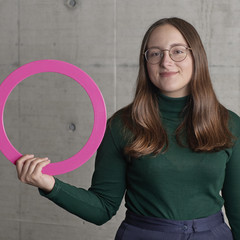



![[Translate to Français:] Frauenwochenende Physik-Olympiade 1](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_Frauenwochenende_Physik-Olympiade_1_76690ff79a.jpeg)

